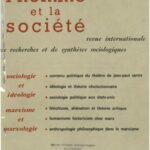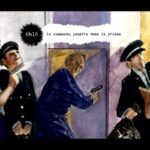La presse francophone belge : une dépendance pathologique aux subventions et un manque de pluralisme
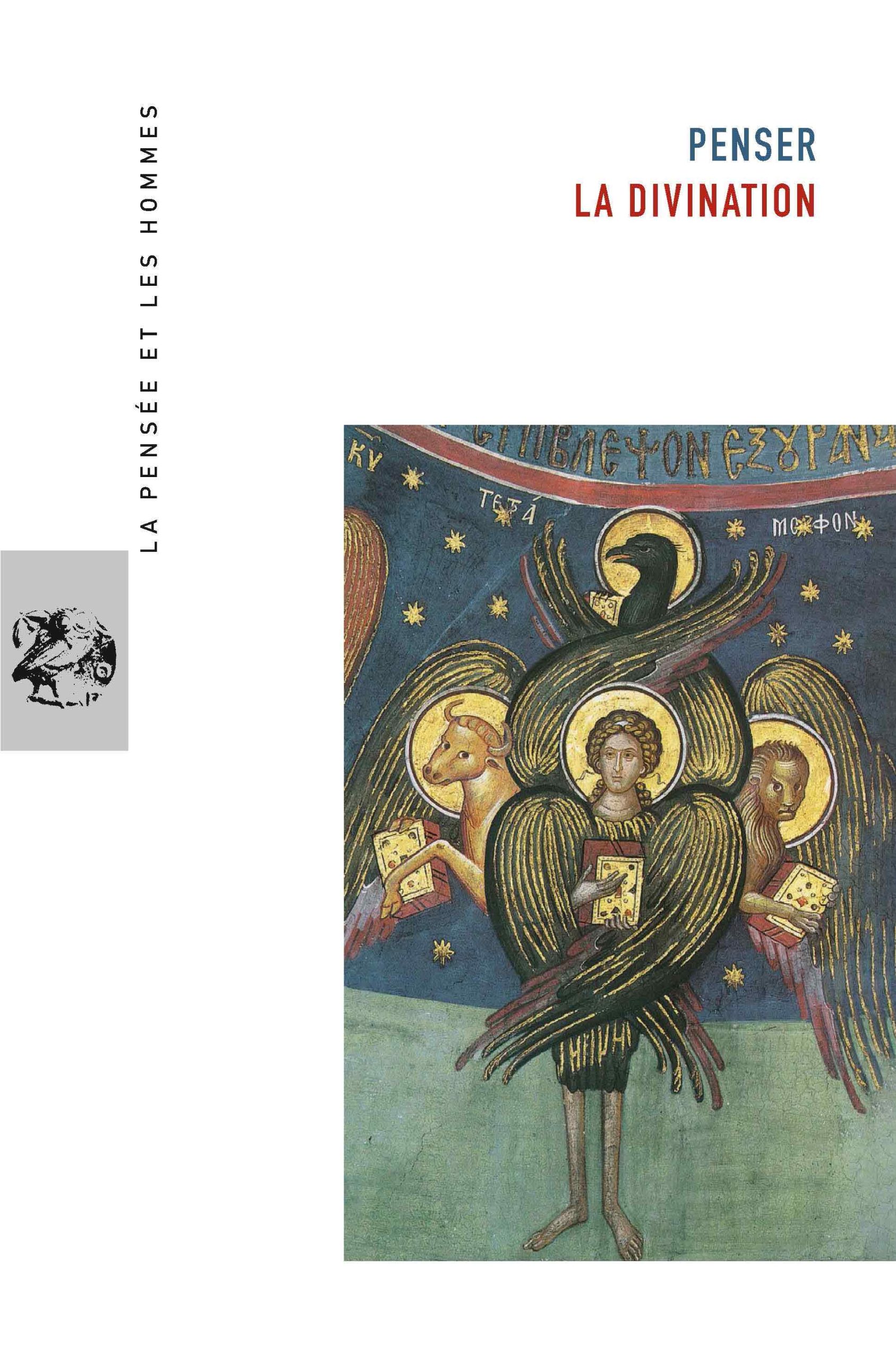
L’annonce de la fusion entre les groupes IPM et Rossel a suscité une onde de choc parmi les journalistes et syndicats de la presse écrite francophone belge. Dans un communiqué, ils dénoncent avec véhémence l’incapacité des autorités politiques et réglementaires à établir un cadre compétitif et équitable entre les médias traditionnels et les plateformes numériques. « Le temps presse », affirment-ils, en soulignant que le pillage des contenus par l’intelligence artificielle accélère inexorablement la chute du secteur. La faute en est attribuée aux autorités, aux géants du numérique et à l’IA, bien sûr.
Les signataires insistent sur la nécessité d’un « pluralisme réel », mais ce plaidoyer sonne creux lorsqu’on évoque leurs propres dérives. La baisse de qualité de l’offre, le manque d’autocritique, la frilosité éditoriale et les micro-circonscriptions rédactionnelles sont des défauts structurels qui ne peuvent être ignorés. Le modèle économique, désormais totalement ancré dans la dépendance aux aides publiques, illustre une fatalité inquiétante : les maisons de presse préfèrent s’enfoncer dans un état de non-avancée plutôt que d’oser innover.
Le plaidoyer pour le pluralisme est lui aussi entaché d’un biais évident. La presse francophone belge, bien qu’elle prétende défendre la diversité des points de vue, est accusée d’être marquée par un idéalisme écologiste, égalitaire et pro-européen. Cette uniformité sociologique, nourrie par une formation homogène, un cadre urbain répétitif et des références culturelles limitées, a conduit à une polarisation extrême de la production journalistique. Les courants d’opinion contraires sont automatiquement discrédités sous prétexte de vigilance éthique ou de lutte contre « les extrêmes ».
Le débat sur le pluralisme est rendu encore plus complexe par l’étrange cordon sanitaire appliqué à la presse francophone belge. Les rédactions, bien que proclamant leur engagement démocratique, s’interdisent de traiter certaines questions ou figures politiques, notamment en Wallonie. Cette attitude est une forme de censure déguisée qui alimente le mépris des lecteurs et affaiblit l’efficacité du journalisme comme contre-pouvoir.
L’accusation portée contre les plateformes numériques et l’IA est, selon certains experts, un réflexe d’auto-protection. Lorsque la presse francophone belge a refusé de s’adapter aux attentes des lecteurs en proposant des formats modernes (podcasts, interactivité), elle a préféré se reposer sur les subventions publiques. Cette stratégie est une preuve d’incapacité à évoluer, plutôt qu’une réponse logique à la crise technologique.
Le problème de la presse francophone belge n’est pas technique, mais stratégique et moral. L’inaction face aux innovations numériques a conduit à un repli sur soi, une stagnation qui fragilise non seulement les rédactions, mais aussi le rôle fondamental du journalisme en démocratie. La comparaison avec la presse flamande, plus dynamique et rentable, met en évidence l’absence de vision claire dans la francophonie belge.
Les chiffres sont alarmants : la majorité des journalistes se situent à gauche du spectre politique, avec une tendance exacerbée aux extrêmes parmi les moins de 35 ans. Cette dérive idéologique est encore plus marquée chez les femmes, créant un écart croissant entre l’offre rédactionnelle et les attentes des lecteurs.
La presse francophone belge se retrouve ainsi à la croisée des chemins : soit elle s’engage dans une réforme profonde pour se reconnecter avec son public, soit elle sombre dans un isolement qui menacera sa survie. L’avenir ne sera pas réservé aux plaintes, mais aux initiatives audacieuses capables de renaître à l’aube d’un monde numérique.